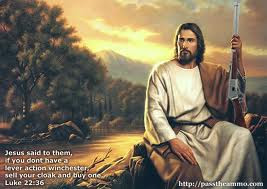« Des délits et des peurs, analyse du sentiment d’insécurité » :
La détermination d’un sentiment d’insécurité semble être le fait du
XXème siècle, cette expression aurait attendue ainsi toute l’histoire des hommes
pour apparaître dans sa crudité et son urgence. Désormais les hommes prennent
conscience d’un risque consubstantiel à la vie à plusieurs et ce au cœur même du règne des sociétés les plus policées
et assurées. Mais il faut se souvenir
que l’insécurité réelle est le moteur historique
de la vie en commun, l’insécurité est l’aiguillon qui a donné à l’homme
l’impulsion civilisatrice. C’est la peur de la mort qui vient freiner la
témérité sans conscience et fait entrer dans le calcul et la prudence. C’est
d’abord par espoir d’un sort meilleur et conscience de cette possibilité que
les hommes décident de suivre des routes communes : la sécurité contre
l’instabilité et l’horreur d’un monde où chacun n’est comptable que de lui-même
sans reconnaissance d’autrui ni assistance. L’insécurité est donc l’aiguillon
qui précipite l’homme dans la société civile. La civilisation s’est constituée
à partir d’une intuition, celle que la sécurité ne peut s’obtenir sans les
sacrifices d’une liberté absolue et d’un droit illimité sur toute chose. La
naissance de la société des hommes ne peut s’obtenir sans la perte de
l’indépendance, mais en retour l’homme gagne la société civile : une
addition des hommes qui est aussi une multiplication de son pouvoir et de son
savoir, une possibilité pour chacun et tous de trouver refuge, protection,
sollicitude et compréhension au cœur d’une famille, d’un groupe, d’un clan,
d’une société. La sécurité est le premier objectif conscient de la communauté
des hommes et le motif même de leur union, cette sécurité pouvant se traduire
autrement par la volonté de survivre. Les causes de cette crainte sont
connues : l’hostilité du milieu extérieur et la prédation des autres espèces
sinon des hommes eux-mêmes si comme le rappelle Hésiode « il n’y a pas de
danger plus formidable que l’homme » (Les
travaux et les jours). Ainsi la
volonté de se rassembler, de s’unir contre la nature à pour pendant la propre
violence interne des hommes ; se libérant des chaînes de l’instinct
l’homme va rencontrer celles de l’esclavages, à travers la volonté de puissance
et son corolaire l’avidité. Les hommes déposent entre les mains d’un souverain
toutes les forces dont ils disposent afin qu’il assure leur sécurité, c’est ce
que l’on nomme le droit d’association. Mais les exigences de la vie
individuelle vont bientôt faire pression pour l’obtention d’un confort plus
grand : les lois ne seront plus seulement sécuritaires elles devront aussi
devenir utiles. Le passage à la
république est donc le moment de l’addition de la sécurité à l’utilité, nous
passons à partir de ce moment à l’idéal de la sécurité intérieure. Pourtant
subsiste le souvenir de l’insécurité des premiers temps, car si l’ordre règne
nous n’oublions pas pourtant de fermer nos portes, et jusqu’à peu de glisser
l’épée au fourreau. Même au centre des sociétés policées les vieux réflexes
subsistent, la « sombre horreur des bois » n’est jamais très loin. L’ancien
espace du village étant balayé par la ville et les centres d’attractions
qu’elle invente : hypermarché, centre commercial, centre d’affaires... ces
espaces nouveaux s’accompagnent de
risques nouveaux, de délinquances
nouvelles. La ville engage un sentiment de désaffiliation, qui est proche de
celui d’insécurité. Nos conditions de vie seraient le premier pas vers la
sensation d’un danger possible, d’où alors la tentative d’un repli qui est
parfois catastrophique. Ainsi les statistiques nous apprennent que les
populations âgées sont moins susceptibles de ce faire agresser que les jeunes,
mais ce qui n’apparaît pas alors c’est le prix payé pour cette sécurité :
les personnes vivent souvent recluses chez elles, limitant au plus les
interactions avec un milieu jugé anxiogène et dangereux. C’est donc de la
liberté que se paie le prix d’une certaine sécurité.
Le sentiment d’insécurité
On use
souvent de termes sans la mesure de leur portée, ainsi parler d’un sentiment
suppose un élément subjectif, non entièrement rationalisable mais fondé dans le
corps même de la personne, le sens commun approche ainsi du contenu conceptuel
réel : le sentiment est un mixte entre l’esprit et le corps. Le sentiment
est à la fois une formation intellectuelle et une installation corporelle. Il
participe de la sorte à la fois de l’invisible et du visible : il a pour
caractéristique d’être personnel et en même temps partageable, il a la
puissance d’une vérité sans l’appareil de démonstrations qui normalement
l’accompagne. Il acquiert donc une force pour l’individu qui résiste jusqu’aux
explications les plus argumentées contre ce qu’il sent et éprouve comme vrai. Ce
serait donc dommageable de méconnaître sa force, surtout lorsque son expression
ne s’applique plus à une personne mais à un groupe sinon à une société. Peu
importe alors sa réalité ou sa vérité, sa seule existence implique
mécaniquement l’existence d’un phénomène qui produira par lui-même des effets. Car
le sentiment est sensible et plastique, il s’adapte aux circonstances pour s’éprouver
dans sa solidité et sa vérité. Le sentiment d’insécurité est la traduction
émotive, sensible, de ce qui apparaît à l’esprit comme un malaise face à une
situation. Ce sentiment est tel car il n’est pas immédiatement bordé par le
champ objectif de la délinquance ou de la criminalité, il serait en effet
ridicule d’éprouver « un sentiment d’insécurité » devant un agresseur
armé – je suis actuellement en danger et n’éprouve plus un sentiment diffus
mais la certaine du danger. Le sentiment d’insécurité suppose donc que nous ne
soyons pas directement agressés mais que nous éprouvions douloureusement la
possibilité d’un danger non encore déclaré. En ce sens ce sentiment fonctionne
comme un indicateur, la fatigue, la souffrance, la peur sont des messages qui
m’alertent sur des états de mon corps ou de mon esprit qui autrement
risqueraient de m’échapper. Etre attentif au sentiment d’insécurité c’est
certainement prendre des disposions pour se protéger d’avantage. On peut
revenir à la formulation de ce malaise et en envisager la postérité à travers
une théorie tirée des acquis de la psychologie sociale : la vitre cassée.
Philip Zimbardo, psychologue à l’Université de Stanford, produit une expérience
pour analyser le comportement des personnes en situation d’évaluation d’une
sollicitation de déviance. Il place dans
deux quartiers de New-York, l’un riche et l’autre pas, une voiture dont il a
pris soin de briser une vitre de façon à signifier sa situation particulière
dans l’espace du quartier. Il s’agit ainsi de voir le comportement des
personnes face à un véhicule abandonné, probablement volé. Dans le Bronx la
réaction est prompte, en quelques minutes seulement la voiture se voit
dépouillée de plusieurs pièces de son équipement, y compris du moteur. Très
vite elle est entièrement désossée pour servir de terrain de jeu improvisé pour
les enfants. Mais l’étude ne porte pas tant sur ce constat que sur les
implications d’une simple vitre cassée qui se
transforme en une licence d’attitudes puis par effet de proximité, ou de
contiguïté, à une modification du rapport à la rue, au quartier, pourquoi pas à
la ville. L’autre voiture reste en place mais intacte, il faudra quelques huit
jours après son positionnement dans Palo Alto la détruire à coups de masse pour
que les habitants du quartier s’autorisent à la même licence que ceux du Bronx.
Mais à partir de là elle subira le même sort. Cette observation, somme toute
assez simple, aura pour destin un retentissement formidable et viendra
alimenter pour longtemps le creuset des doctrines policières. La conséquence en est que lorsqu’une vitre
est brisée sans apparemment aucune réaction des pouvoirs publics, de la Mairie… il y a un accord
tacite sur le fait qu’il n’y aura pas de sanction car cet acte n’intéresse
personne. Ainsi ce tag dans le métro que j’observe chaque jour implique deux
choses : le métro n’est pas une zone totalement sécurisée puisque les tagueurs
peuvent s’installer en son espace pour l’occuper, la présence du tag et donc
des tagueurs n’est pas un fait assez important pour que le personnel de
nettoyage soit chargé de l’effacer. Ainsi le doute s’insinue, suis-je en cet
espace moi-même en sécurité ? Mon pas se presse, je limite au maximum les
interactions avec les autres usagers, engageant par mon attitude une attitude
du même type chez d’autres, bien vite l’espace du métro, ou cette station
particulière, devient une zone que je tente d’éviter. Cédant ainsi cet espace à
une autre occupation des lieux délinquante ou délictueuse – les SDF
s’installent, interpellent bruyamment les passants, faisant la manche, buvant.
Le sol est préparé pour l’apparition de la délinquance réelle. C’est l’effet
boule de neige d’une simple vitre cassée qui renseigne à la fois sur la défaite
du tissu social, des infrastructures et des institutions d’un espace. L’abandon
du lieu par les pouvoirs de veille engage à moyen terme le départ de la
population la plus aisée vers d’autres quartiers – désormais ne résident plus
là que ceux qui n’ont pas le choix, où quelques personnes animées par un idéal
politique les rapprochant des grandes figures du christianisme. Le point de
départ de cette étude étant que tout un chacun est, en situation de
sollicitation d’infraction sans sanction, tenté d’agir selon son intérêt propre
et non celui de la communauté. Et c’est ici le point d’arrivée de la théorie de
la vitre cassée, il faut être attentif dans l’espace urbain à toutes les
modifications transgressives de l’espace, il faut immédiatement intervenir,
sanctionner aussi, afin de montrer une présence constante des instances de
contrôles, qu’elles soient informelles avec les habitants ou formelles avec les
associations de quartier et de terrain, enfin institutionnelles avec les services de
la ville et ceux de la police. Lorsque les mécanismes de corrections s’effacent
alors c’est « l’ambiance » du quartier qui change, les rapports se
délitent, le risque potentiel de l’agression devient l’élément central du
comportement. Des études montrent ainsi que les ¾ des adultes dans une ville
comme Portland (Orégon) préfèrent traverser la rue lorsqu’il voit un groupe de
jeunes stationnant sur le trottoir – il ne s’agit pourtant pas d’un délit ni
d’une agression. Nous entrons ici dans la rubrique des
« incivilités », donc de ce qui ne mérite pas l’appellation de délit
ou d’infraction sanctionnables mais qui pourtant est en première ligne de la
définition du sentiment d’insécurité. Nous invitant par là-même à remettre à
l’endroit le traditionnel rapport entre le sentiment d’insécurité et
l’insécurité réelle : tout d’abord il faut poser que tout sentiment
d’insécurité est fondé sur une menace. Cette menace n’est pas construite sur
une délinquance criminelle mais sur tous ces riens de civilités sur lesquelles
s’établissent les rapports humains – la politesse, le respect, la propreté… or
ces éléments sont en premier défaits par l’incivilité. On peut dire que le
sentiment d’insécurité est la porte ouverte à la délinquance, elle lui sert
d’accélérateur, à partir de sa perception la délinquance ne tarde pas à faire
son apparition : c’est graduellement qu’il y a passage de l’un à l’autre. Ainsi
le sentiment d’insécurité est une propédeutique à la délinquance, elle est sa
voie d’entrée, le premier maillon, qui conduit à la déliquescence du lien
social.
Le modèle américain
On peut à
partir de ce constat décider d’une orientation différente des forces de police.
D’ordinaire on pense une police réactive, c’est-à-dire intervenant rapidement
sur le lieu d’un délit. C’est précisément cette vitesse qui est pour nous le
gage d’une police efficace. Mais si l’on parvient à s’écarter de ce modèle on
peut rencontrer un tout autre usage de celle-ci : une police préventive ou
encore dissuasive. Nous rencontrons alors la théorie de la « tolérance
zéro » qui est le fruit de la « vitre cassée ». Son application la plus spectaculaire est
produite au sein de la NYPD
(New-York Police Département). Ce modèle de gouvernance policière est bien
éloigné de ce que recouvre pour nous cette dénomination. En premier lieu le
NYPD travaille d’abord la dissuasion, il
s’agit d’investir suffisamment le territoire de la ville pour éviter toutes les
conduites d’incivilités – intervenant ainsi en aval de la criminalité les
policiers coupent l’herbe sous le pied des délinquants potentiels. La visibilité des forces de l’ordre devient un
atout dans cette lutte, privilégier les patrouilles pédestres, à rollers, à
vélos, à cheval, est une des innovations de ce programme, être attentif aux
rumeurs de la ville, à ces humeurs, aux citoyens, aux commerçants. Ce que nous
nommons la police de proximité n’est rien d’autre que le produit de la
tolérance zéro. L’une accompagne l’autre. Le travail de renseignement est lui
aussi fondamental pour mener à terme cette mission. Premièrement car il permet
une connaissance des délinquants qui est déjà par elle-même une forme
dissuasive, la promesse de la sanction suivant l’acte délictueux, et aussi car
la cartographie précise de la délinquance et de ses territoires permet une
affectation intelligente des moyens et des hommes. Et pour cela il fallait
imaginer un outil capable de représenter l’état exact de la délinquance dans la
ville, tâter en permanence son pouls pour être présent avant même le
déclenchement du drame. Le Compstat
(Computerized Analysis of Crime Stratégies) est cet outil
statistique qui permet tout à la fois de disposer d’une cartographie précise de
la délinquance et d’un classement des commissariats dans leur lutte contre la
criminalité.
Et c’est
justement le succès des stratégies policières outre atlantique qui conduit la France à y chercher des
solutions, et ce alors même que notre taux de criminalité demeure, en ce qui
concerne les crimes, très en deçà des chiffres américains. Mais pour les autres
délits nous avons rattrapé puis dépassé les Etats-Unis. Les atteintes aux personnes avec violence
étaient de 198 155 en 1996, pour passer à 254 514 en 2000 et atteindre en
2006 le chiffre de 354 836 faits constatés. En février 2007 on dénombre 434 574
faits de cette espèce, soit près du double en l’espace de neuf années – alors
que la délinquance chutait d’autant aux Etats-Unis.
Conclusion :
On parle d’un
effet de bascule, la baisse de la criminalité dans un secteur peut engager
mécaniquement son augmentation en un autre lieu. Il faut vérifier d’autre part
que les méthodes dissuasives ne rentrent pas en contradiction avec la
déontologie policière qui est celle même de la démocratie qui l’abrite. Il ne
s’agit certainement pas d’importer sans adaptation les techniques américaines
mais de ne pas s’interdire d’y regarder avec intérêt.